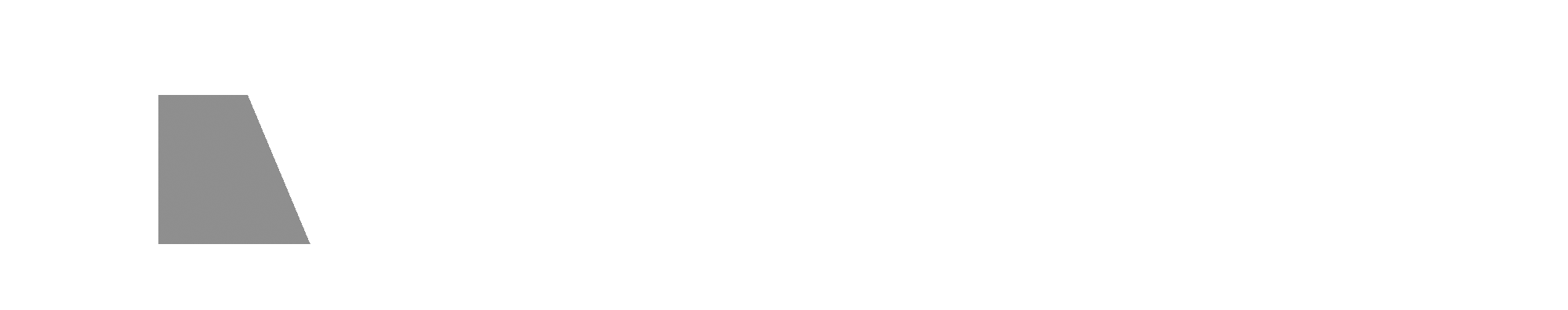à propos de son film Un Pasteur (71′, Little Big Story)

Un Pasteur est mon premier film, je l’ai terminé l’année de mes trente ans. Un peu comme Félix, le jeune berger habité du film, j’ai senti une vocation à l’adolescence et je ne me suis jamais détourné du chemin. Après avoir beaucoup pleuré devant le Kid de Charlie Chaplin étant enfant je n’ai pas arrêté de réclamer à mes parents de voir des films. En rentrant de l’école je trainais des pieds devant l’immense vidéoclub de la rue Montorgueil. Au lycée, j’ai découvert les films d’après-guerre de Rossellini, le cinéma américain des années 70 et les premiers films des frères Dardenne. Je me suis construit avec le cinéma, il a aiguisé ma sensibilité et m’a aidé à mieux comprendre les gens et le monde autour de moi.
Après une classe d’hypokhâgne option cinéma j’ai échoué aux concours d’entrée de la Fémis et de l’INSAS. Déçu, j’ai continué à étudier la littérature et le cinéma à Paris 7 et j’ai obtenu une licence. En master j’ai candidaté à un échange d’un an avec une Université à San Martin, dans la banlieue de Buenos Aires. Ils proposaient des cours de cinéma documentaire assurés par une petite école qui venait d’ouvrir au sein de la fac, sous le patronage de Fernando Birri. La vivacité et la liberté formelle du cinéma documentaire m’ont décidé à poursuivre cette voie. De retour en France j’ai intégré le master de cinéma documentaire ‘’DEMC’’ de l’université Paris 7. Au cours d’un stage de fin d’étude à l’INA, j’ai assisté Serge Viallet qui réalisait à l’époque la merveilleuse série Mystères d’Archives. Puischez Agat Films, j’ai rencontré Sébastien Lifshitz que j’ai assisté ponctuellement pendant plusieurs années sur certains de ses derniers films (Adolescentes, Petite Fille, Madame Hoffman). Le temps passé auprès de Serge et Sébastien a été mon école de cinéma.
De mes vingt trois à mes trente ans, j’ai enchainé des petits boulots sur des tournages de films de fictions pour devenir indépendant et accéder au statut d’intermittent du spectacle. Pendant cette période, quelques ami·es m’ont confié l’image de leur court métrage et je me suis orienté vers le métier de cadreur. Mais le désir de réaliser un film se faisait de plus en plus grand.
Avant de commencer à écrire Un Pasteur, j’avais déjà commencé à tourner. Je prenais des notes sur mes rushs mais je repoussais l’écriture du film, je ne savais pas trop par où commencer. Et puis il y a eu le covid, l’enfermement, le temps suspendu. Cela m’a poussé à écrire. J’ai passé trois semaines devant mon ordinateur et j’ai répondu à l’appel à projet des pitchs d’Addoc. Le film a été sélectionné et à l’issue de l’atelier et du pitch, de nombreuses sociétés de production étaient intéressées par le projet. Je me suis engagé avec Valérie Montmartin de Little Big Story avec qui je continue à travailler aujourd’hui. Parallèlement, mon projet avait été sélectionné pour participer à la résidence d’écriture de Ty films à Mellionnec en Bretagne. C’est là que j’ai rencontré Anne Paschetta, qui m’a accompagné durant les quatre semaines que dure la résidence.
De mars à juin, je retrouvais régulièrement Anne pour une semaine de travail riche et passionnante à la maison des auteurs de Ty films, où nous avancions ensemble sur la réécriture du dossier. Nous alternions des marches dans les bois où nous cherchions des références cinématographiques qui nous inspirent, où nous parlions du personnage et de l’histoire que je souhaitais raconter avec des sessions d’écriture au coin du feu. Anne m’a permis de comprendre à quel point la solitude était un thème dominant du film et elle a trouvé les mots pour raconter un personnage qui se dévoile à travers des gestes et des regards. Le soir, nous regardions des films en lien avec nos questionnements esthétiques. Ces semaines ont été très formatrices, Anne m’a appris à raconter sans expliquer et m’a aidé à faire émerger le personnage de Félix, à le mettre au centre de l’histoire. Entre chaque semaine d’écriture je repartais tourner. Les nouveaux rushs nourrissaient l’écriture, et ce que nous trouvions en termes de récit me guidait lors des tournages. Une méthode de travail que je continue de suivre avec mon nouveau projet de film. Coup sur coup, j’ai obtenu l’aide à l’écriture de la région Sud, la bourse brouillon d’un rêve de la Scam et l’aide à l’écriture du CNC/FAIA.
Les aides au développement et à la production ont suivies l’année suivante. J’ai commencé à monter avec Agathe Hervieu par sessions. Entre chaque sessions de montage, je retournais filmer auprès de Félix. Ainsi le tournage du film s’est enchevêtré avec l’écriture puis avec le montage. Cet entremêlement des étapes de travail qui d’habitude s’enchainent, m’a permis de prendre du recul sur chaque geste et de revenir en arrière quand cela était nécessaire.
Enfin, j’ai terminé le film avec Tania Goldenberg et lors des dernières semaines de montage, nous avons lancé la composition de la musique avec Julien Ribot. Encore une fois le travail sur la musique s’est fait en même temps que les dernières semaines de montage, ce qui a permis d’intégrer la musique de manière organique au film.
Le film a été présenté dans plus de trente festivals (dont Visions du réel, le FIPADOC, DokFest Munich, Verzio Human Rights Film Festival, les rencontres de la photo d’Arles) et remporté une quinzaine de prix. Il a été diffusé sur France 3 et la RTS.
Aujourd’hui je me lance dans la réalisation d’un deuxième long-métrage, Bad Boys Can Cry, qui suit Erdem, un jeune turc qui boxe avec le cœur pour devenir champion de muay thaï du Rajadamnern Stadium à Bangkok et remporter un prime, qui pourrait changer sa vie et celle de sa famille restée en Turquie.